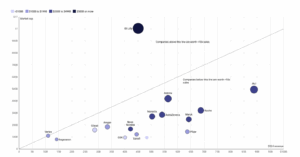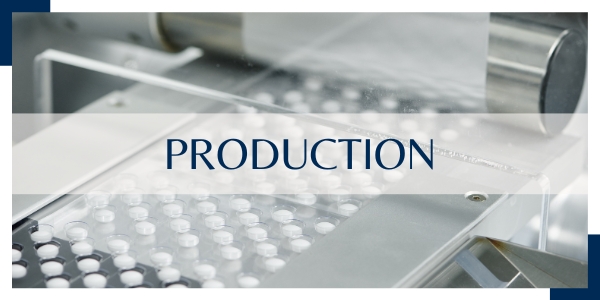
Quelques nouvelles d’investissements industriels en France
3 Laboratoires ont communiqué récemment sur leurs investissements en production pharmaceutique : CHIESI, MAYOLY et SANOFI.
CHIESI
Chiesi (3,4 Md€ de CA dont 230 M€ pour sa filiale française) vient d’inaugurer une nouvelle unité de production à la Chaussée-Saint-Victor (41), près de Blois, où elle exploite une usine qui emploie environ 300 collaborateurs. Le site vient en effet de réceptionner un nouveau module de production qui sera dédié à la fabrication d’aérosols doseurs à empreinte carbone minimale (près de 90 % de réduction par rapport à un aérosol classique). Ce projet qui s’inscrit dans un programme d’investissement global de 160 M€ engagé depuis une dizaine d’années, va permettre de doter l’usine d’une capacité annuelle de 57 millions d’aérosols low carbon à l’horizon 2027, avec, à la clef, la création d’une cinquantaine d’emplois supplémentaires.
MAYOLY
A l’occasion de Choose France, Mayoly annonce le rapatriement en France de la production de la colchicine, un médicament d’intérêt thérapeutique majeur. Ce projet représente un investissement de 2,5 millions d’euros pour relancer la fabrication en France, sur le site du sous-traitant pharmaceutique Galien à Auxerre (Yonne).
À Dammarie-les-Lys (Seine-et-Marne), Mayoly vient d’inaugurer deux nouvelles lignes de production de Meteospasmyl, médicament de gastroentérologie présenté sous forme de capsules molles, distribué dans plus de 50 pays. Cet investissement de 15 millions d’euros permet de doubler ses capacités à plus de 25 millions de boîtes par an. Ces lignes de nouvelle génération ont été conçues pour allier performance industrielle, ergonomie et moindre impact environnemental. Elles s’accompagnent de la création de 40 emplois qualifiés d’ici fin 2026,
SANOFI / Lisieux et Compiègne
À l’occasion du salon Choose France qui s’est tenu récemment, les dirigeants d’Opella ont confirmé que 40 M€ d’investissements de production – 25 M€ pour Lisieux, 15 M€ pour Compiègne – allaient bien être investis d’ici à la fin 2026.
Le programme industriel va notamment se traduire par l’installation d’un nouveau granulateur à Lisieux, une usine de formes solides qui se consacre exclusivement à la production et au conditionnement du Doliprane pour le marché français (entre 250 et 300 millions d’unités produites annuellement).
Sources : Communiqués de presse des entreprises