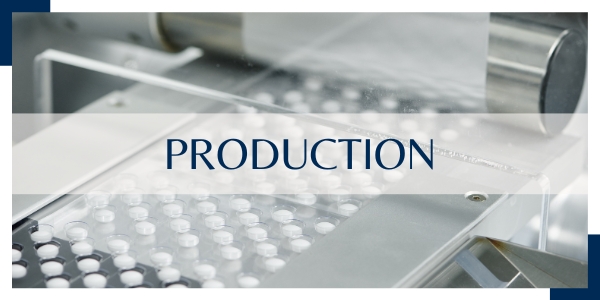Quelques actualités du dispositif médical
Parmi les informations, nouveaux organismes notifiés, rapport du projet COMBINE, guide sur les produits borderline et produits combinés du TGA, nouvelle plateforme de l’HAS.
Ces derniers jours, 3 organismes notifiés ont été désignés selon le règlement RDM. Il s’agit de MTIC InterCert S.r.l.(0068, Italie), Kiwa Belgelendirme Hizmetleri A.Ş. (1984, Turquie) et de QMD Services GmbH (2962, Autriche).
Une mise à jour du document « Information on the applications for designation as a notified body – Overview of CABs/NBs at each stage of a designation process » a été publiée sur le site de Commission Européenne.
Dans le cadre du projet COMBINE, initié en juin 2023, la Commission, les autorités nationales, les comités d’éthique, l’Agence européenne des médicaments et les parties prenantes publie un rapport dans lequel sont analysés les défis actuels rencontrés lors de la réalisation d’études combinées et les solutions possibles pour rationaliser le paysage réglementaire en Europe.
Pour rappel, les études combinées sont des études dans lesquelles les médicaments sont évalués en même temps que les dispositifs médicaux ou les diagnostics in vitro).
La publication du rapport constitue la première phase du projet. Les prochaines étapes consisteront à développer certaines des solutions proposées.
RAPS et Elemed ont publié la deuxième édition du livre blanc « 2024 Global Regulatory Affairs Professionals Workforce Report », qui donne un aperçu de la taille et de la santé de la profession des affaires réglementaires. Les statistiques comprennent notamment : répartition par secteur, ouvert à l’emploi, niveau d’emploi, taille de l’entreprise, principaux lieux d’implantation, principaux employeurs, niveau d’études, nombre d’années dans le poste actuel, nombre moyen d’années d’expérience…
Les données contenues dans cette publication donnent également un aperçu du point de vue de la communauté des affaires réglementaires sur la myriade de changements auxquels la profession a été confrontée au cours des dernières années. Les résultats de 2024 sont comparés aux résultats du rapport de 2021.
Le TGA a publié un guide sur les produits borderline et produits combinés afin d’aider les promoteurs à déterminer si leurs produits thérapeutiques sont des médicaments, des produits biologiques ou des dispositifs médicaux.
Le 1er mai 2024, la HAS a modifié sa plateforme de dépôt dématérialisé pour les dossiers de demande de remboursement des dispositifs médicaux numériques. La Haute Autorité de santé a ouvert début mai Sésame, une nouvelle plateforme de dépôt dématérialisé pour les dossiers de demande de remboursement des dispositifs médicaux numériques en remplacement de l’ancienne plateforme d’Evatech. Au-delà du mode d’emploi mis à disposition sur son site, la HAS a procédé à la mise à jour de son guide Prise en charge anticipée d’un dispositif médical numérique pour accompagner le dépôt d’un dossier auprès des ministres chargés de la Santé et de la Sécurité sociale et de la Commission nationale d’évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé (Cnedimts). Cette version du 30 avril 2024 intègre les modifications liées à la bascule de la plateforme Evatech vers Sésame.
Source : Commission Européenne, RAPS, TGA, DSIH