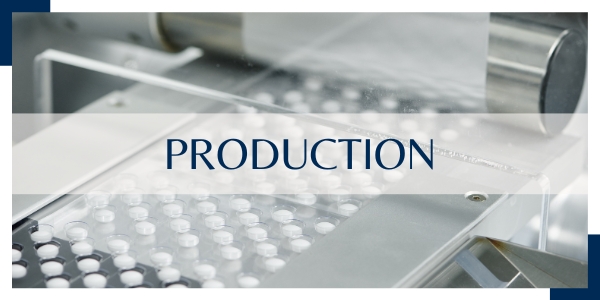SANOFI et sa position sur les vaccins anti-grippe
Sanofi a annoncé fin septembre être visé par une enquête de la Commission européenne, celle-ci précisant qu’un éventuel abus de position dominante dans le domaine des vaccins était examiné.
C’est une annonce faite par une déclaration auprès de l’AFP.
« Sanofi confirme que des représentants de la Commission européenne se sont rendus aux sièges de Sanofi en France et en Allemagne le 29 septembre 2025 dans le cadre d’une enquête sur son comportement dans le secteur des vaccins contre la grippe saisonnière ».
Dans le même temps, la Commission européenne avait déclaré qu’elle avait mené des perquisitions chez un groupe pharmaceutique, mais sans préciser son identité. Ces investigations portent sur une éventuelle violation de la politique de concurrence de l’Union européenne « qui interdit d’exploiter de manière abusive sa position dominante sur les marchés », avait souligné la Commission dans un bref communiqué. Les enquêteurs ont été rejoints par les autorités de concurrence locales, précise le texte.
Ces perquisitions ne signifient pas que l’entreprise en question est coupable de comportement anticoncurrentiel, ajoute la Commission. Sanofi, de son côté, s’est dit « assuré d’avoir respecté les règles et réglementations concernées ». Le groupe a prévenu qu’il ne ferait pas plus de commentaires à ce stade.
Les vaccins antigrippaux constituent une activité majeure pour Sanofi qui en développe plusieurs. Ils sont largement administrés dans le cadre de campagnes annuelles de vaccination comme celle qui commencera en France le 14 octobre.
Parmi ses concurrents figurent notamment l’américain Viatris ou l’australien CSL Seqirus.
Sources : Communiqués de presse AFP, Articles Le Monde, Le Figaro, les Echos.