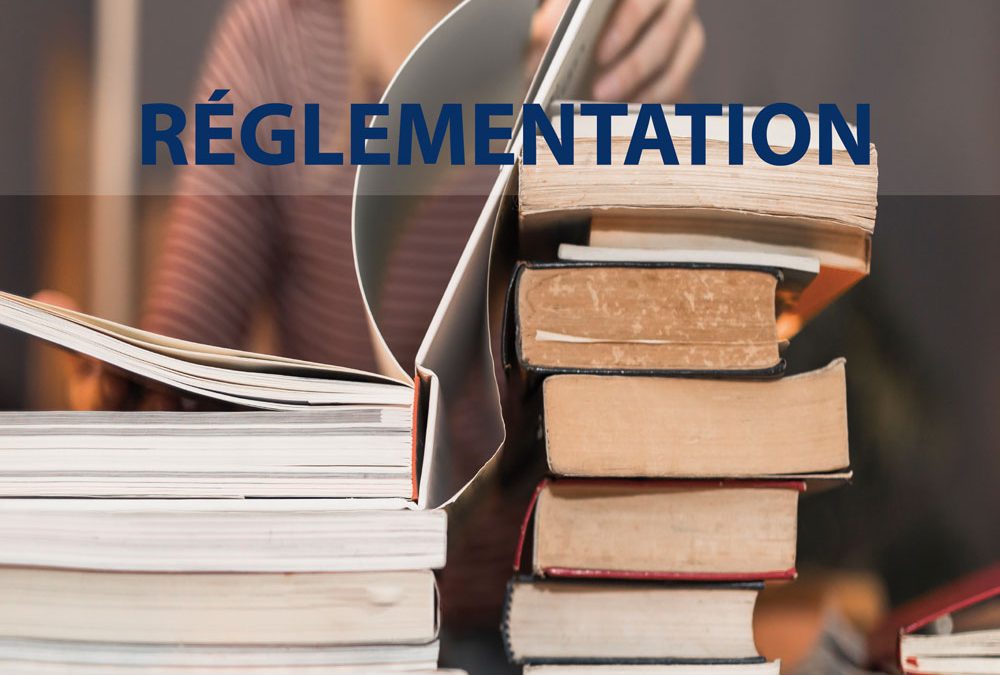Développement d’un médicament : les chiffres clés !
Le développement pharmaceutique se doit d’innover afin de mettre rapidement sur le marché les médicaments attendus par les patients. Voici le rappel de quelques chiffres clés.
Le processus de recherche et développement (R&D) de nouveaux médicaments est de plus en plus complexe.
En 2019, l’industrie pharmaceutique a dépensé 83 milliards de dollars en R&D, soit environ 10 fois ce que l’industrie dépensait par an dans les années 1980.
Mais la durée moyenne de développement d’un nouveau médicament est toujours d’environ 10 à 15 ans.
Avec la moyenne estimée coût de développement d’un médicament approchant les 2,3 milliards de dollars en 2022, le retour sur investissement (ROI) moyen projeté en R&D n’était que de 1,2 %.
La nécessité de générer des revenus suffisants pour alimenter des dépenses de R&D sans cesse croissantes a donc conduit à une tarification des médicaments d’une manière de plus en plus inabordable dans de nombreux pays et régions, voire totalement inaccessible. Le problème croissant de l’accès inéquitable n’est pas seulement un problème de pays en développement ou émergents ; des disparités importantes dans la disponibilité des médicaments existent en Europe où le délai entre l’approbation réglementaire (autorisation de mise sur le marché) et l’accès réel pour les patients peut varier de quelques jours à 2,5 ans.
Environ 90 % de l’investissement requis pour développer de nouveaux médicaments est le coût de la réalisation d’essais cliniques Ceci est une conséquence des coûts énormes impliqués dans l’établissement de centres de recherche, le traitement des patients et l’évaluation des résultats. De plus, seul un composé sur 10 (sur 10 000 testés et évalués au stade préclinique) passe avec succès les tests d’essais cliniques et l’approbation réglementaire, de sorte qu’un succès doit couvrir le coût des autres échecs. L’un des principaux facteurs contributifs aux coûts élevés, l’industrie dépend fortement des organisations de recherche sous contrat (CRO) pour mener des essais cliniques, ce qui a toujours pris beaucoup de temps et de ressources.
Source : European Pharmaceutical Review