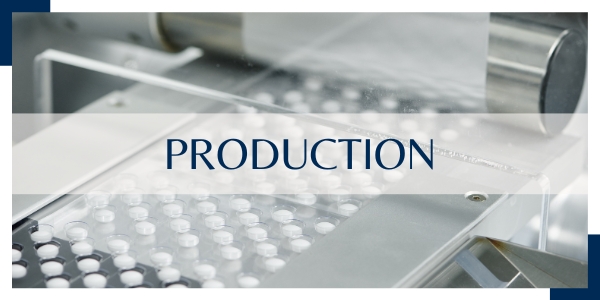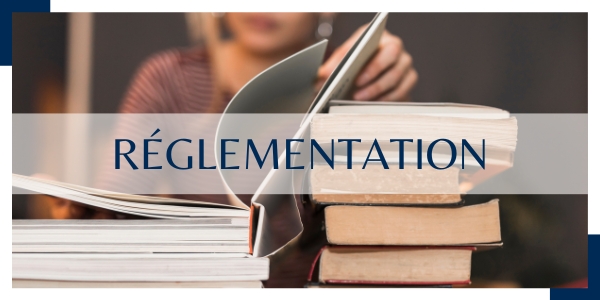
PME : Résultats de l’enquête de l’EMA
Les petites et moyennes entreprises (PME) ont demandé à l’Agence européenne des médicaments de simplifier et de rationaliser les réglementations afin d’alléger certaines des charges qui pèsent sur leurs activités.
Le règlement (CE) n° 2049/2005 de la Commission, adopté le 15 décembre 2005, a introduit des dispositions spécifiques visant à soutenir les petites et moyennes entreprises (PME) du secteur pharmaceutique. Son objectif était de favoriser l’innovation et de faciliter le développement de nouveaux médicaments par les PME.
L’EMA a lancé une enquête en 2024 afin de recueillir les avis et les commentaires des PME et des organisations parties prenantes sur le fonctionnement et l’impact de ce règlement. L’enquête visait également à identifier les défis actuels auxquels sont confrontées les PME, afin de garantir que les mesures de soutien restent pertinentes et adaptées aux besoins évolutifs des PME du secteur biopharmaceutique.
L’enquête en ligne a donné lieu à 266 réponses uniques et valides. Elle a révélé “une grande satisfaction à l’égard du soutien de l’EMA, en particulier des services d’assistance réglementaire, des incitations tarifaires, du processus de qualification des PME et de la formation”, a déclaré l’EMA dans son rapport. Les personnes interrogées ont fait l’éloge d’outils tels que le guide de l’utilisateur pour les PME, mais la connaissance de certains services était limitée.
L’enquête a également mis en lumière des problèmes, les répondants ayant souligné des défis tels que la charge réglementaire, l’accès au financement et les frais réglementaires, appelant à la simplification et à la rationalisation de la réglementation, à l’accès au financement et à l’amélioration des conseils et de l’assistance”, a noté l’EMA.
Un cinquième des répondants a cité la charge administrative et réglementaire comme un défi. Plus précisément, les PME ont indiqué à l’agence qu’elles étaient confrontées à des défis liés aux réglementations sur les technologies médicales et les essais cliniques, au manque d’harmonisation des exigences entre les autorités et à l’évolution des demandes liées à des produits innovants tels que les thérapies ciblées et les diagnostics compagnons.
Dans leurs réponses, les PME ont suggéré que l’EMA simplifie et rationalise les cadres réglementaires pour le développement et l’approbation des médicaments et des technologies, qu’elle introduise des flexibilités et des exemptions pour les procédures ou les exigences réglementaires, et qu’elle améliore les conseils réglementaires et scientifiques tout au long du cycle de vie du produit. D’autres suggestions portent sur le soutien aux procédures décentralisées.
Près de 60 % des personnes interrogées ont déclaré que l’EMA devrait développer ses services d’assistance réglementaire. L’enquête a également révélé que les PME souhaitent que l’agence réduise les délais des processus et procédures réglementaires et renforce son soutien après l’autorisation d’un produit.
L’accès au financement (19 %) et les frais de réglementation (13 %) sont les deux autres défis les plus fréquents pour les PME. Les répondants ont proposé d’alléger les frais réglementaires pour les PME grâce à des incitations financières nationales et de l’EMA avant et après autorisation, à des modalités de paiement flexibles (par exemple, reports, versements échelonnés) et pour des activités spécifiques telles que la sérialisation (législation sur les médicaments falsifiés). Ils proposent également d’améliorer le guide sur les incitations financières pour les PME prévues par le règlement (UE) 2024/568 relatif aux frais et redevances dus à l’EMA.
L’enquête a également porté sur les pénuries de médicaments. 80% des personnes interrogées n’ont pas connu de pénurie de médicaments au cours des deux dernières années. Environ 50 % des PME n’étaient que peu ou pas du tout au courant des obligations et des processus de notification des pénuries. Les PME ont cité la longueur des procédures réglementaires et des approbations, telles que les autorisations et les inspections, comme un défi lié à la pénurie de médicaments.
Les répondants ont enfin suggéré que l’EMA simplifie les cadres réglementaires et aligne les exigences dans l’ensemble de l’UE, aide les PME à préparer des plans de prévention et d’atténuation des pénuries, et introduise des incitations financières pour soutenir les procédures réglementaires visant à prévenir et à gérer les pénuries de médicaments.
Source : RAPS, EMA