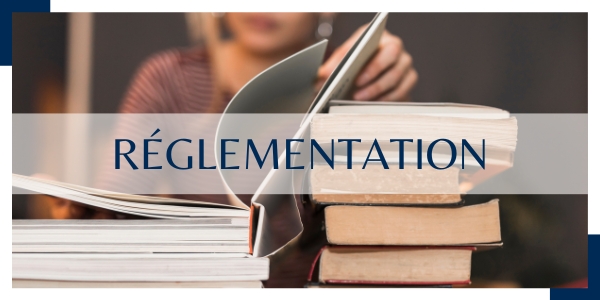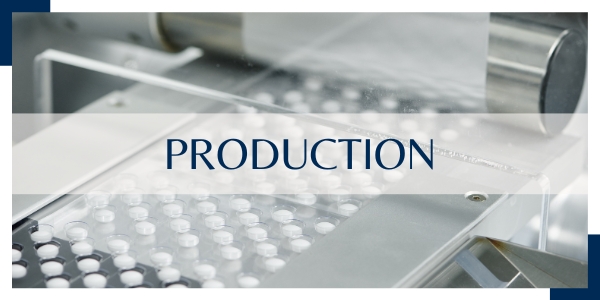
Les difficultés d’un fabricant français d’API
Le groupe AXYNTIS, spécialisé en production d’API, est « sous le feu de la rampe » à cause des difficultés financières de ses filiales.
Le fonds américain Sandton Capital Partners, avait pris le contrôle au printemps 2024 d’AXYNTIS, la holding détenant Orgapharm et deux autres sociétés de chimie fine.
Selon Actu Labo et la République du Centre, ORGAPHARM, une société située à Pithiviers (45), fabriquant des principes actifs prioritairement destinés à l’industrie pharmaceutique, qui était en procédure de conciliation depuis plusieurs mois, a été placée en redressement judiciaire pour cessation de paiements le 29 avril par le tribunal de commerce d’Orléans.
En 2023, Orgapharm avait dégagé 12,8 M€ de pertes pour un CA de 28,5 M€, en recul de près de 20 % par rapport à l’exercice précédent.
Le fonds américain n’aurait pas souhaité venir au secours d’un groupe en difficulté depuis la crise Covid. Il a mis fin au mandat du directeur général nommé lors de son arrivée, obligeant David Simonnet, président et fondateur d’Axyntis, à reprendre les commandes de son groupe, épaulé par un directeur des opérations recruté récemment.
En mai 2023, Axyntis avait dû accepter la liquidation de Synthexim, sa filiale calaisienne issue de la reprise dix ans plus tôt de Calaire Chimie.
En octobre dernier, son autre filiale Centipharm (7,6 M€ de CA pour 2,7 M€ de pertes en 2023) était placée en redressement judiciaire avant que le tribunal de commerce de Grasse (06) se rétracte le mois suivant, le créancier ayant été remboursé entre-temps. Selon David Simonnet, la situation de Steiner, un fabricant de colorants industriels de St-Marcel (27), se serait spectaculairement améliorée l’an passé après plusieurs années de pertes : Axyntis chercherait à le céder et plusieurs offres sont à l’étude.
Interrogé par la presse locale, David Simonnet indique qu’Orgapharm a un carnet de commandes bien garni, avec quelque 10 M€ de produits à livrer dans les trois mois. La période d’observation arrivera à échéance fin octobre avec une nouvelle audience prévue fin juin.
Sources : Actu Labo et la République du centre