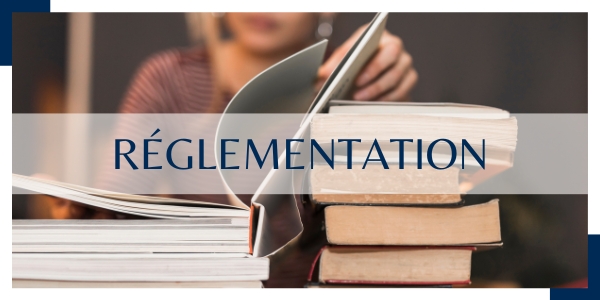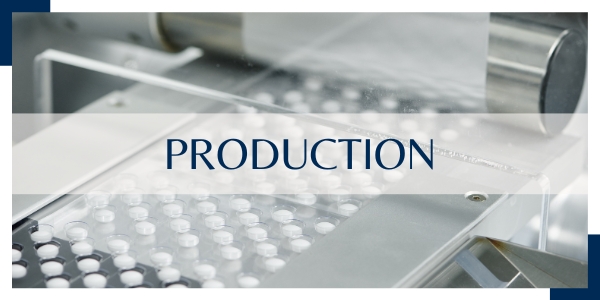
Vers une Impression 3D de médicaments en production BPF ?
L’entreprise montpelliéraine MB Therapeutics propose des médicaments bioimprimés, avec une solution de cartouches prêtes à l’emploi, pour un début de fabrication (passer de la paillasse à la production dans les conditions BPF), dès 2026.
Le journal Usine Nouvelle a interviewé le dirigeant de MB THERAPEUTICS.
« MB Therapeutics a été créé sur la base d’une dizaine d’années d’expérience », rappelle ainsi Stéphane Roulon qui a lancé l’entreprise en 2023, après une expérience dans le développement, acquise sur le site montpelliérain de SANOFI.
Annoncée de longue date, l’impression 3D de médicaments se confrontait jusqu’à présent au casse-tête réglementaire pour les entreprises soucieuses de se lancer sur ce marché. Comment imprimer sans passer par l’ensemble des contraintes de production qui encadrent la fabrication pharma ?
« Nous avons vu très clair sur la marche à suivre et notre projet a été construit autour de la démarche réglementaire, prise en compte dès l’origine », rappelle Stéphane Roulon.
Automatisée, adaptée à des petits lots de production, la technologie est capable de réaliser des traitements au dosage varié. « L’idée est d’avoir une combinaison entre une formulation de qualité industrielle et une délocalisation de la production par impression 3D », explique Stéphane Roulon.
La start-up va développer dans un premier temps des formulations pour la pédiatrie. L’imprimante fabriquera des comprimés de petite taille orodispersibles, facilement acceptés par les enfants.
L’entreprise se positionne ainsi à l’avant-garde de la médecine personnalisée. Stéphane Roulon explique : « Prenons l’exemple du paracétamol : il est connu pour avoir de potentiels impacts sur le foie. Si mon besoin se limite à 0,75 g au lieu des 1 g généralement prescrits et délivrés en pharmacie, notre processus permet de produire un médicament contenant uniquement cette dose adaptée. De plus, dans le même médicament, nous pouvons intégrer un autre principe actif correspondant à mon traitement pour une insuffisance cardiaque, si cela m’a été prescrit. Contrairement aux traitements standardisés, nous proposons des solutions personnalisées. »