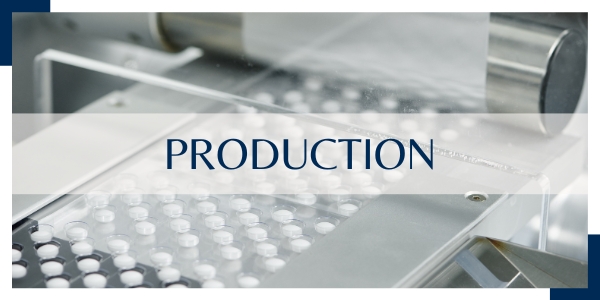Publications de la Commission Européenne
Elargissement des conditions d’utilisation des eIFU, FAQ relatif aux interactions entre RDM/RDMDIV et IA Act, obligations liées aux MDSW.
Le 25 juin, la Commission a publié une mise à jour du règlement d’application qui élargit considérablement les informations pouvant être communiquées aux professionnels de la santé par le biais d’eIFU. En vertu du règlement précédent, les eIFU étaient limités à certains dispositifs destinés aux professionnels de santé et ne pouvant raisonnablement pas être utilisés par les patients, tels que les dispositifs implantables et les dispositifs implantables actifs et leurs accessoires, les dispositifs fixes installés et certains logiciels.
Toutefois, au début de cette année, la Commission a demandé aux parties prenantes si elle devait étendre le règlement à d’autres types de dispositifs. Les parties prenantes ont convenu que les eIFU seraient plus pratiques et plus efficaces pour les fabricants et les professionnels de la santé.
Sur la base des commentaires des parties prenantes, la Commission a donc élargi le champ d’application du règlement à tous les dispositifs médicaux et leurs accessoires couverts par le règlement (UE) 2017/745 qui sont destinés à des utilisateurs professionnels. Cela inclut les dispositifs qui relèvent des dispositions transitoires de l’article 120 du règlement relatif aux dispositifs médicaux (RDM) et ceux qui n’ont pas de finalité médicale prévue énumérée à l’annexe XVI du RDM.
Toutefois, la Commission a également déclaré que pour les dispositifs destinés à être utilisés par des professionnels et qui pourraient éventuellement être utilisés par un consommateur, la notice d’utilisation doit toujours être fournie sous forme papier.
La Commission a déclaré qu’à partir du moment où l’enregistrement des dispositifs dans la base Eudamed deviendra obligatoire, les fabricants devront fournir à la base de données UDI d’Eudamed l’adresse Internet sous laquelle la notice d’utilisation électronique est accessible.
Du côté des guides du MDCG, la Commission Européenne a publié deux guides en juin :
MDCG 2025-6 : Ce document apporte des réponses sur certains aspects de l’interaction entre les règlements sur les dispositifs médicaux (RDM et RDMDIV) et la loi sur l’intelligence artificielle (AI Act) comme par exemple :
• La loi sur l’IA n’a pas d’incidence sur la classification des dispositifs médicaux utilisant l’IA. Au contraire, c’est la classification des dispositifs médicaux en vertu du RDM ou du RDMDIV qui détermine la classe de risque en vertu de la loi sur l’IA.
• La loi sur l’IA renforce l’obligation des fabricants de veiller à ce que le dispositif reste sûr et performant pendant toute sa durée de vie.
• Comme le RDM et le RDMDIV, la loi sur l’IA oblige les fabricants à mettre en place un système de gestion de la qualité pour les dispositifs IA. Les obligations du système de gestion de la qualité de la loi sur l’IA sont complémentaires du système de gestion de la qualité exigé en vertu du RDM ou du RDMDIV.
• Selon les dispositions relatives à l’IA, la documentation technique des dispositifs médicaux utilisant l’IA doit inclure diverses informations telles que les détails de la conception du dispositif, le développement, les choix clés en matière de conception, la fonctionnalité, les caractéristiques de performance, l’architecture du système, les ressources informatiques pour le développement, la formation et les essais, l’utilisation et la finalité prévues, la preuve de la conformité avec les exigences réglementaires pertinentes.
• Les exigences de transparence de la loi sur l’IA renforcent les exigences de transparence du RDM ou du RDMDIV dans le cadre des exigences générales de sécurité et de performance.
• Le RDM, le RDMDIV et la loi sur l’IA soulignent la nécessité de mettre en place des mesures de cybersécurité solides.
MDCG 2025-4 : Ce document explique les obligations des fournisseurs de plateformes d’applications et leurs responsabilités en vertu des règlements sur les dispositifs médicaux (RDM et RDMDIV) et du Digital Services Act (DSA).
Il précise notamment que le téléchargement d’une application MDSW (medical device software) par un fabricant correspond à la « mise sur le marché » (à titre onéreux ou gratuit). La période pendant laquelle l’application MDSW est disponible sur le fournisseur de la plateforme d’application correspond à la « mise à disposition sur le marché ». Le fournisseur de plateforme d’application est considéré comme un opérateur économique dans la chaîne de distribution lorsqu’il met ses propres MDSW à la disposition des utilisateurs. Deux scénarios sont présentés dans le guide.
Le MDCG 2025-4 fournit également une liste d’informations à fournir avec le MDSW conformément au RDM et au RDMDIV. Cette liste vise également à faciliter le respect des exigences du DSA par les fournisseurs de plateformes d’applications.
Par ailleurs, en juin 2025, le groupe MDCG a également mis à jour le MDCG 2019-11. Ce document fournit des conseils sur la qualification et la classification des logiciels conformément au RDM et au RDMDIV. Entre autres, la version révisée inclut davantage de considérations sur l’objectif visé par le MDSW, des clarifications sur le champ d’application des logiciels de l’annexe XVI, et de nouveaux exemples.
Sources : European Commission, RAPS, MDlaw.eu