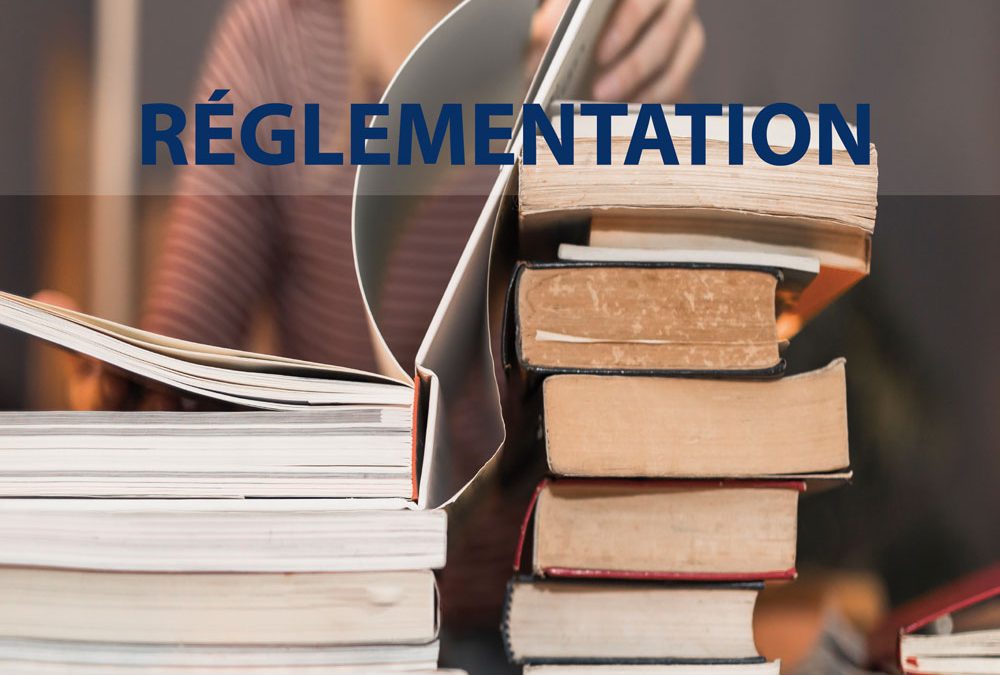
Une nouvelle commission à la HAS.
La HAS a officialisé la création en son sein d’une commission d’évaluation des technologies de santé diagnostiques, pronostiques et prédictives (CEDiag), présidée par Anne-Claude Crémieux.
S’inscrivant dans le plan national « Innovation Santé 2030« , la CEDiag préparera les délibérations du collège portant sur des actes comme les examens de radiologie, de médecine nucléaire, d’anatomocytopathologie ou encore de biologie médicale, qui représentent actuellement 80% des évaluations d’actes professionnels réalisées par la HAS en vue de leur remboursement.
Elle pourra évaluer certains médicaments ou dispositifs médicaux, voire des tests intégrés dans une stratégie de dépistage, et centralisera au sein d’une seule commission des évaluations jusqu’ici réalisées par quatre instances différentes: la commission de la transparence (CT), la commission nationale d’évaluation des dispositifs médicaux et technologies de santé (Cnedimts), la commission recommandations, pertinences, parcours et indicateurs (CRPPI) et la commission d’évaluation économique et de santé publique (Ceesp).
La CEDiag aura aussi pour mission d’élaborer des guides méthodologiques pour aider les professionnels de santé et les industriels dans le développement des innovations diagnostiques. Trois guides sont en cours d’élaboration et devraient être publiés d’ici la fin de l’année:
- un sur les fondamentaux de l’évaluation des technologies diagnostiques, pronostiques et prédictives
- le second sur sa doctrine, qui précisera notamment les critères d’évaluation
- le troisième sur l’évaluation des technologies diagnostiques impliquant de l’intelligence artificielle.
Outre sa présidente, Anne-Claude Crémieux, la CEDiag est composée de 21 membres dont des médecins, des pharmaciens, des spécialistes en méthodologie et des patients/usagers.
Source : HAS (Missions et composition de la commission d’évaluation des technologies de santé diagnostiques, pronostiques et prédictives)




