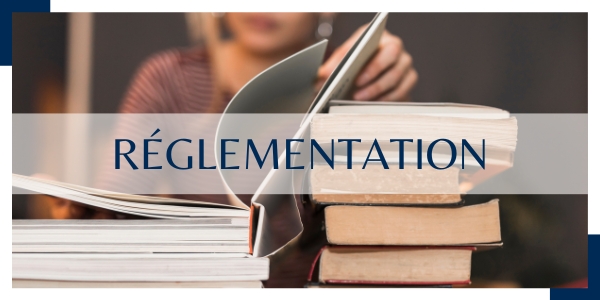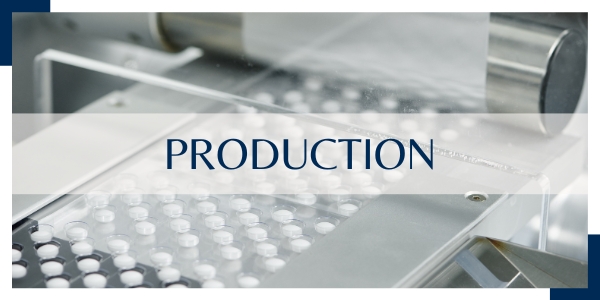Un vaccin contre le VIH développé en France par NAOBIOS
NAOBIOS, une CDMO française basée à Nantes va réaliser le développement pharmaceutique d’un vaccin contre le VIH de la société coréenne SUMAGEN.
NAOBIOS annonce la signature d’un partenariat avec Sumagen, une société de biotechnologie coréo-canadienne développant un candidat vaccin contre le VIH (sérotype 1). Naobios va réaliser le développement de procédés et la production de lots cliniques, pour les essais cliniques de phase II pilotés par Sumagen. Les termes financiers n’ont pas été divulgués.
Naobios pilotera le processus de production du candidat vaccin anti-VIH complètement inactivé de Sumagen en vue de confirmer son innocuité et son efficacité dans le cadre d’un essai clinique de phase I. Naobios poursuivra ensuite le développement du procédé afin de préparer le vaccin anti-VIH-1 pour les essais cliniques de phase II.
Grâce à son site de production qui offre une biosécurité de niveau 3 (BSL3), Naobios dispose des capacités nécessaires pour développer et produire des vaccins contre des virus hautement pathogènes, tels que le VIH, pour lesquels aucun vaccin n’a encore été identifié. Naobios s’occupera des activités de développement et d’optimisation des processus pendant un an, puis du lancement de la production aux normes BPF pour les essais cliniques de phase II.
« Nous sommes ravis que Sumagen nous ait confié le développement et la production de leur candidat vaccin anti-VIH, qui pourrait être le premier à obtenir une autorisation de mise sur le marché, » déclare Eric Le Forestier, directeur général de Naobios. « Grâce à nos années d’expertise en matière de développement et de production de vaccins viraux, nous sommes sûrs de pouvoir accompagner Sumagen dans les prochaines étapes de leur développement clinique. »
Source : ALA associates