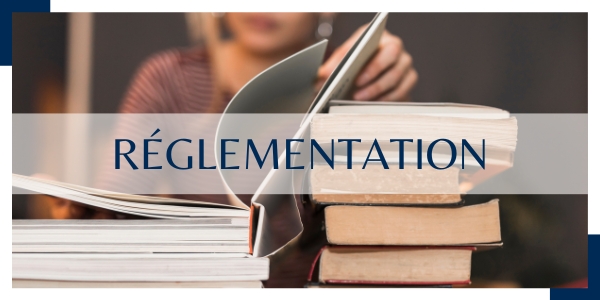Ouverture d’une enquête de la Commission Européenne concernant les pratiques commerciales de la Chine, vote du Parlement Européen concernant les DMDIV et EUDAMED, mise à jour de guides/documents de l’IMDRF, du MHRA, mise en ligne d’un guide par SwissMedtech.
La Commission européenne a lancé une enquête pour examiner la manière dont la Chine favorise ses entreprises nationales dans les appels d’offres pour les dispositifs médicaux et évaluer d’éventuelles mesures de représailles.
Bruxelles accuse depuis longtemps Pékin de recourir à des pratiques discriminatoires qui empêchent les entreprises européennes de remporter des marchés publics en Chine dans le secteur précieux des dispositifs médicaux, où l’Union européenne conserve un avantage concurrentiel.
Ces pratiques incluent des processus de certification stricts, des systèmes d’approbation opaques, des clauses de sauvegarde des « intérêts nationaux » et des demandes de prix anormalement bas que les fabricants étrangers sont tout simplement incapables de satisfaire. En raison de la politique « Achetez chinois », l’industrie européenne des dispositifs médicaux a dénoncé à plusieurs reprises le fait que les appels d’offres publics chinois, auparavant ouverts aux importations, demandent désormais spécifiquement des produits fabriqués en Chine.
L’Allemagne, les Pays-Bas, l’Irlande, la France, la Belgique et l’Italie figurent parmi les principaux exportateurs mondiaux de dispositifs médicaux.
L’enquête, annoncée mercredi dernier, s’appuiera sur les informations fournies par les États membres et les entreprises, ainsi que sur le dialogue avec les représentants chinois, et durera jusqu’à neuf mois, avec une prolongation possible de cinq mois.
Elle a été ouverte à la demande de la Commission, plutôt qu’à la suite d’une plainte.
Si l’enquête confirme l’existence des pratiques suspectées, la Commission sera en droit d’imposer des mesures de rétorsion à la Chine afin d’équilibrer la concurrence entre les deux parties. Les entreprises chinoises pourraient ainsi se voir interdire complètement l’accès aux marchés publics dans l’ensemble de l’UE, un marché ouvert d’une valeur de plus de 2 000 milliards d’euros.
La Commission peut également limiter l’interdiction aux appels d’offres dépassant une certaine valeur ou imposer des conditions qui réduisent le score des candidats chinois.
L’enquête pourrait prendre fin à tout moment si Pékin accepte de remédier à la situation et de garantir la réciprocité aux fournisseurs européens, bien que cela n’ait pas été le cas dans d’autres secteurs économiques où Bruxelles a soulevé des objections.
Le 25 avril 2024, le Parlement européen a voté en faveur de la proposition visant à étendre les dispositions transitoires pour les legacy devices relevant du RDMDIV, à introduire un déploiement progressif de l’EUDAMED ainsi qu’un système de notification pour l’interruption de l’approvisionnement de certains DMDIV ou dispositifs médicaux critiques.
La décision a été adoptée à la majorité de 511 voix.
Nouvelles dispositions du RDMDIV pour les legacy devices :
Le Conseil de l’Union européenne a approuvé la proposition de la Commission européenne en février 2024. À l’instar des prolongations du MDR de l’année dernière, la Commission a proposé de prolonger la période de transition pour les legacy devices relevant du RDMDIV jusqu’aux dates suivantes :
- 31 décembre 2027 pour la classe D et les dispositifs couverts par un certificat CE IVMDD
- 31 décembre 2028 pour la classe C
- 31 décembre 2029 pour les classes B et A stérile
Cette période prolongée ne s’applique que si le fabricant prend des mesures cruciales en vue de la transition vers le RDMDIV, telles que l’approche d’un organisme notifié (avant le 26 mai 2025 pour la classe D, avant le 26 mai 2026 pour la classe C et avant le 26 mai 2027 pour les dispositifs stériles de classe B et de classe A), et la mise en place d’un système de gestion de la qualité conforme au RDMDIV avant le 26 mai 2025.
Plan de déploiement d’EUDAMED et notification d’interruption de l’approvisionnement
La proposition prévoit un déploiement progressif des modules EUDAMED. Les premiers modules pourraient devenir obligatoires peu après avoir été audités et déclarés fonctionnels, ce qui est prévu pour 2025 :
- Module Acteurs (les acteurs doivent s’enregistrer dans les 6 mois suivant la date à laquelle le module est déclaré pleinement fonctionnel)
- Module UDI/Dispositifs (les dispositifs doivent être enregistrés dans les 12 mois suivant la date à laquelle le module est déclaré pleinement fonctionnel)
- Module Organismes notifiés/Certificats (les certificats doivent être téléchargés dans les 18 mois suivant la date à laquelle le module est déclaré pleinement fonctionnel).
- Cela remplacerait la situation actuelle où EUDAMED ne devient obligatoire que lorsque tous les modules sont disponibles. Il est important de noter qu’une inscription unique à EUDAMED remplacera les multiples inscriptions nationales.
Enfin, pour éviter toute perturbation du marché, les fabricants doivent informer au préalable les autorités compétentes de l’UE lorsqu’ils prévoient une interruption de la fourniture de certains DMDIV ou dispositifs médicaux critiques.
Prochaine étape : Le Conseil doit maintenant approuver officiellement le texte avant qu’il ne soit publié au Journal officiel de l’UE (attendu en mai).
Une mise à jour du document de l’IMDRF « Principes d’étiquetage des dispositifs médicaux et des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro » a été publié.
Le document s’applique à tous les dispositifs médicaux, y compris les dispositifs médicaux DIV, et vise à spécifier le contenu général et le format de l’étiquetage des dispositifs médicaux et des dispositifs médicaux DIV en format papier ou électronique. Ce document fournit des principes généraux d’étiquetage, y compris des sections spécifiques de l’étiquette, des instructions d’utilisation et des informations destinées au patient. Les exigences de toute norme pertinente spécifique aux dispositifs médicaux ou aux dispositifs médicaux DIV doivent également être prises en compte. Bien que ce document comprenne des principes généraux d’étiquetage, il ne comporte pas de sections traitant d’autres éléments possibles de l’étiquetage.
Swiss Medtech a mis en ligne un guide intitulé : La mise sur le marché suisse ou comment s’assurer que vous pourrez vendre tous vos dispositifs médicaux après le 26.05.2024. En effet, les dispositifs médicaux qui ne sont pas transférés dans le cadre du RDM ne pourront plus être mis sur le marché suisse après le 26 mai 2024. Il y a donc un risque que vous ne soyez plus autorisé à vendre certains produits le 27 mai 2024, même s’ils se trouvent déjà dans votre entrepôt suisse. Swiss Medtech a créé un guide pour minimiser ce risque. Il présente les options de mise sur le marché des dispositifs médicaux en Suisse et garantit que vous n’aurez pas à vous débarrasser de dispositifs médicaux conformes dans votre stock.
Enfin, le MHRA a publié une version révisée du document « Clinical investigations of medical devices – guidance for manufacturers » avec la mise à jour de contacts et liens vers d’autres documents.
Sources : IMDRF, MHRA, SwissMedtech, mdlaw.eu, euronews.com