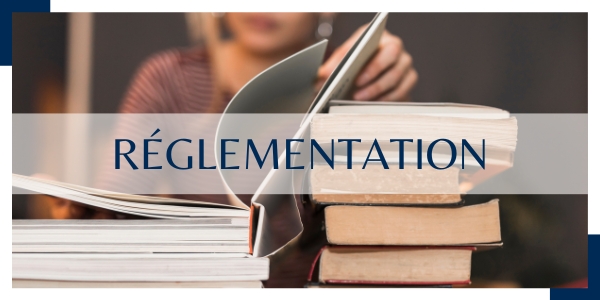PLFSS 2025 : un régime d’économie pour les médicaments !
Dans le PLFSS 2025, il y aura une baisse des prix de médicaments et des sanctions importantes pour les laboratoires qui manquent aux obligations de stock.
Le PLFSS (projet de loi de financement de la sécurité sociale) prévoit une économie de 4 milliards d’euros dans la santé. Côté médicaments, il faut prévoir une baisse de prix des médicaments.
En 2025, l’Ondam est ainsi fixé à +2,8 %, contre 3,3 % en 2024. « C’est 9 milliards d’euros en plus », s’est défendue Geneviève Darrieussecq, ministre de la Santé le 10 octobre.
Sur les produits de santé, le PLFSS prévoit ainsi un coup de rabot de 1,4 milliard d’euros l’année prochaine, dont 1 milliard d’euros économies rien que sur les baisses de prix des médicaments. Pour rappel, les baisses de prix sur le médicament en 2024 étaient estimées à 850 millions d’euros.
Autres économies prévues : 200 millions d’euros de baisse de prix sur le dispositif médical, 400 millions sur « la sobriété des usages » des produits de santé.
Côté industrie pharmaceutique, le PLFSS entend simplifier le mode de calcul de la clause de sauvegarde, mais aussi renforcer les sanctions à l’égard des labos qui ne respectent pas leur obligation en matière de lutte contre les pénuries de médicaments.
Ainsi, le texte propose d’augmenter les pénalités financières envers les industriels qui manqueraient à leur obligation de stock de sécurité pour les médicaments à risque de rupture. Le plafond de la sanction pourrait notamment passer de 1 à 5 millions d’euros.
Le texte 2025 se fait purement budgétaire. À peine quelques lignes pour renforcer les dispositifs de lutte contre les pénuries de médicaments déjà existants.
Source : Revue Pharma