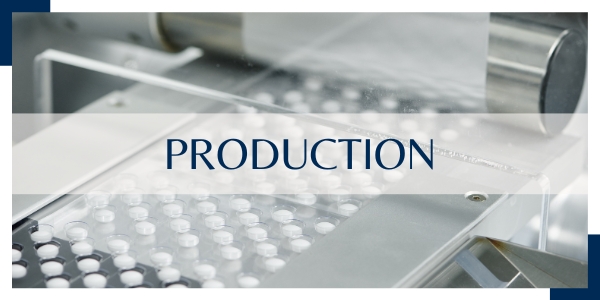EFPIA : rapport 2024 Pipeline Review – Innovation for unmet need.
Le rapport met en évidence une série de facteurs contribuant à un changement majeur dans les types de maladies ayant un impact sur la société.
Le rapport met en évidence une série de facteurs contribuant à un changement majeur dans les types de maladies ayant un impact sur la société. Il s’agit notamment du vieillissement de la population, du changement climatique, des choix de mode de vie et de la résistance aux antimicrobiens (RAM).
Le nombre de personnes âgées de plus de 65 ans devrait doubler d’ici 2050, entraînant une augmentation des cas de démence, de diabète, de BPCO, de dépression et de cancer. Par ailleurs, malgré l’amélioration des traitements au cours des 20 dernières années, les taux de survie restent faibles pour de nombreux cancers. Dans de nombreux pays, l’obésité devrait augmenter et les maladies cardiovasculaires (par exemple l’hypertension) ne sont pas contrôlées, ce qui a des conséquences néfastes sur la santé.
En 2023, l’EMA a délivré 77 autorisations de mise sur le marché, dont 39 étaient de nouvelles substances actives (NSA). Les domaines de traitement de l’oncologie (13) et de la neurologie (7) ont enregistré le plus grand nombre de NSA et représentent ensemble la majorité des approbations de NSA en 2023. Le domaine de traitement de l’hématologie a vu la seule approbation ATMP avec CASGEVY, une thérapie cellulaire basée sur CRISPR utilisée dans le traitement de la drépanocytose et de la bêta-thalassémie.
Les approbations de nouvelles substances actives sont revenues aux niveaux antérieurs à la pandémie en 2023, en partie en raison d’une baisse des approbations pour les indications de maladies infectieuses. Les autorisations de mise sur le marché sont revenues aux niveaux antérieurs à la pandémie, en partie en raison d’une baisse des autorisations exceptionnelles pour les médicaments COVID-19.
En novembre 2024, l’EMA avait délivré 97 autorisations de mise sur le marché cette année, dont 56 pour de nouvelles substances actives.
Le nombre d’essais cliniques parrainés par l’industrie au niveau mondial a diminué depuis le pic atteint en 2021, mais reste supérieur aux niveaux antérieurs à la pandémie. Après une forte augmentation due au COVID-19, le nombre de patients par essai est pratiquement revenu aux niveaux d’avant la pandémie, tandis que le nombre de sites par essai est resté stable. L’oncologie reste le domaine le plus important pour les essais cliniques et représente 29% des essais initiés en 2023. L’oncologie, l’endocrinologie, les maladies cardiovasculaires et les maladies infectieuses présentent la plus grande proportion d’essais de phase 1, ce qui suggère qu’il s’agit d’un domaine d’innovation privilégié.
Ce rapport présente 10 domaines d’innovation spécifiques, dans les pipelines thérapeutiques et d’immunisation :
- Vaccins contre la résistance aux antimicrobiens (les vaccins contre Streptococcus pneumoniae sont au cœur de l’innovation, avec 52 essais lancés depuis 2021).
- Nouveaux antibactériens (97 actifs sont en phase de développement, mais seuls 4 antibiotiques seraient considérés comme innovants et ciblant un pathogène prioritaire).
- Vaccins contre les maladies non transmissibles (trois vaccins prophylactiques contre le virus d’Epstein-Barr sont actuellement en phase initiale de développement, les premières autorisations étant attendues dans les années 2030).
- Vaccins ARNm contre les cancers (Dans le cas du cancer colorectal, trois vaccins à ARNm sont en cours d’essais cliniques P1/P2, la première autorisation étant attendue au début des années 2030).
- Thérapie génique pour la dystrophie musculaire de Duchenne (Plusieurs thérapies géniques basées sur des vecteurs viraux adéno-associés devraient être approuvées pour le traitement de la DMD au cours des cinq prochaines années.
- Technologie de l’ARN pour l’hyperlipoprotéine (a)
- Cellules souches pour les maladies neurodégénératives (Pour la maladie de Parkinson, les thérapies à base de cellules souches en sont actuellement au stade des essais cliniques préliminaires, la première autorisation étant attendue dans les années 2030, mais pourrait être accélérée).
- Médicaments de nouvelle génération pour la prise en charge de l’obésité (L’activité de développement de nouvelles pharmacothérapies pour l’obésité est élevée, avec plus de 120 produits en développement préclinique et clinique).
- Thérapies anti-interleukine dans la BPCO (Plusieurs produits établis sont testés dans le traitement de la BPCO, dont plusieurs sont en phase 3 et proches d’une approbation potentielle).
- Nouvelles thérapies pour le trouble dépressif majeur (L’activité des essais cliniques dans le domaine des troubles dépressifs majeurs est élevée, avec 248 essais lancés depuis 2019).
Source : EFPIA