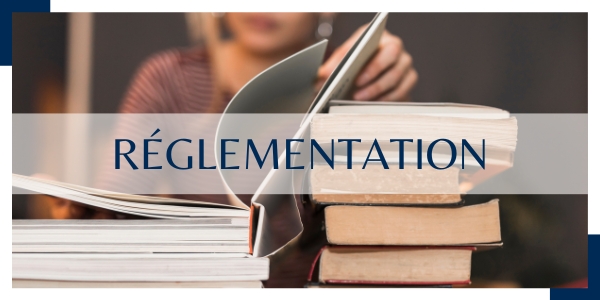Synthèse de molécules prometteuses
Des chercheurs du CNRS, en collaboration avec l’Université Paris-Saclay, ont réussi à synthétiser en laboratoire des molécules thérapeutiques complexes initialement isolées chez les éponges marines.
Ces organismes marins vivent dans des environnements extrêmes, ce qui les pousse à produire des substances chimiques originales pour se défendre, souvent en symbiose avec des micro-organismes. Parmi elles, on retrouve les quinones méroterpéniques, une famille de molécules aux propriétés biologiques puissantes et qui présentent des activités thérapeutiques prometteuses.
Anticancéreuses, antibactériennes, antivirales…, elles sont potentiellement des candidates prometteuses pour le développement de médicaments, notamment contre des maladies résistantes ou difficiles à traiter.
Cependant, leur extraction naturelle pose un double problème : les quantités récoltées sont très faibles et la collecte en mer peut menacer les écosystèmes. Pour contourner cette limite, les scientifiques ont mis au point une stratégie de synthèse totale. Cela consiste à reproduire entièrement la molécule cible en plusieurs étapes, à partir de précurseurs simples, sans dépendre des matériaux d’origine naturelle. Cette approche est d’autant plus innovante qu’elle permet également d’introduire des variations structurelles, ouvrant la voie à de nouvelles molécules inspirées du modèle naturel.
Parmi les succès majeurs de cette étude : la synthèse de deux composés rares, la dactyloquinone A et la spiroetherone A. Grâce à une série originale de réactions chimiques incluant notamment un transfert d’atome d’hydrogène (MHAT) et une réorganisation quinol–énédione, les chercheurs ont pu reconstituer ces structures complexes avec précision. Cela constitue non seulement une avancée dans l’obtention de ces molécules marines, mais aussi un outil précieux pour la chimie médicinale, qui pourra s’en inspirer pour développer de nouveaux candidats médicaments.
Ces résultats, publiés dans la revue Angewandte Chemie, montre le potentiel immense de la synthèse organique moderne pour mimer la nature tout en la préservant, et illustre comment la créativité des chimistes permet d’accéder à des ressources autrement inaccessibles.
Source : CNRS