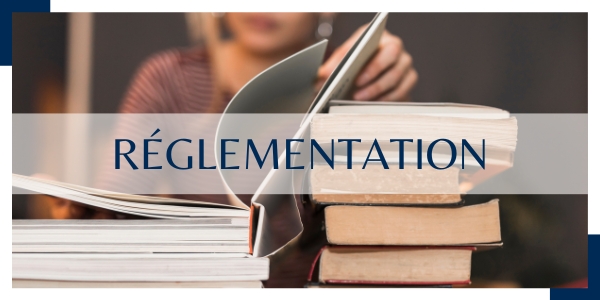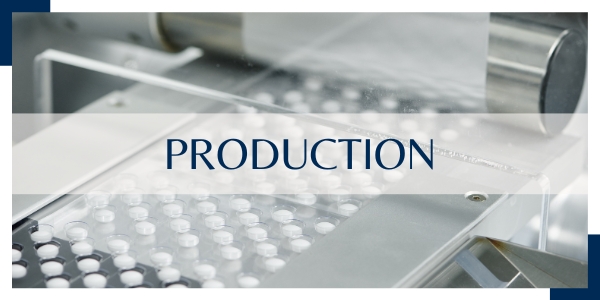
DELPHARM continue son développement au Canada
Le gouvernement de la province de Québec va soutenir DELPHARM et son outil de production à Boucherville.
Les ministres de l’Économie et de la Santé de la province de Québec ont annoncé conjointement que leur administration allait injecter 60 M$ canadiens – soit un peu plus de 37 M€ – pour soutenir l’investissement majeur que consent la CDMO française Delpharm sur le site de Boucherville, dans la banlieue nord de Montréal : cette enveloppe sera partagée pour moitié en prêt et en subvention et complètera celle, d’un même montant (45 M$ de prêt à taux réduit et 15 M$ de subvention), accordée au printemps par le gouvernement fédéral canadien.
L’investissement consiste à agrandir l’usine actuelle de 2 600 m2 et à l’équiper d’une nouvelle ligne de remplissage d’injectables stériles, la spécialité de ce site racheté en 2022 par Delpharm à Sandoz, qui reste son principal client : les produits finis sont majoritairement destinés au secteur hospitalier de toute l’Amérique du Nord.
Delpharm, qui emploie 497 salariés à Boucherville et 206 à Pointe-Claire, à l’ouest de Montréal, vise à accroître la production de l’usine de 80 %, a précisé hier la ministre québécoise de l’Économie Christine Fréchette.
DELPHARM avait choisi d’investir au Canada, pour l’accès au marché Nord-Américain, la qualité des emplis et la stabilité du pays.
Sources : Actu Labo, La Presse