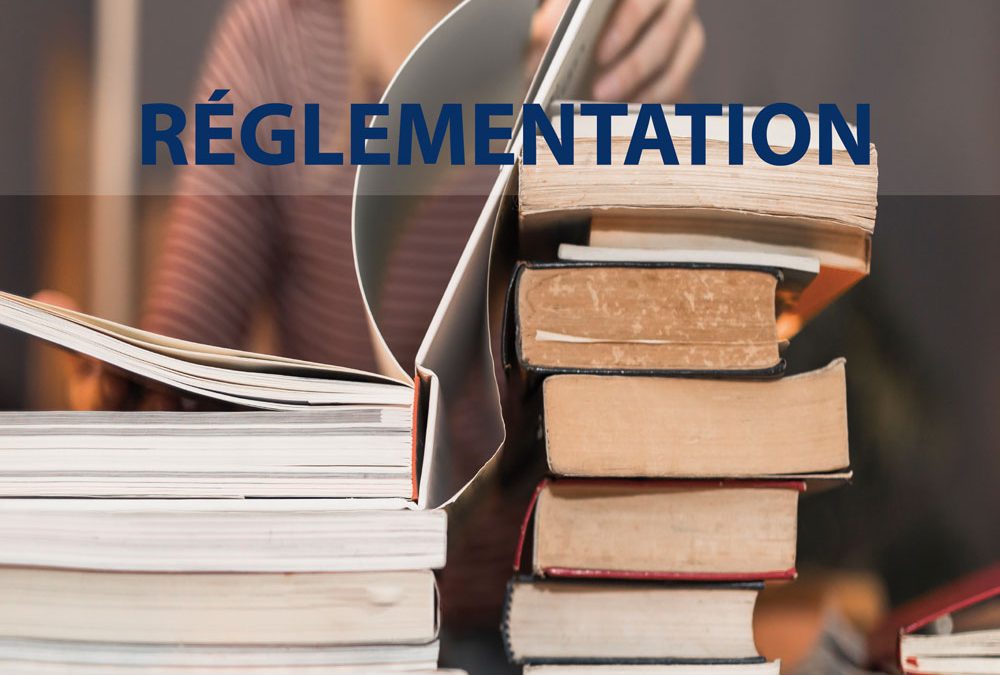Quelques futures pépites à connaître
Dans un récent article, Biopharmadive revient sur les essais cliniques en cours concernant des futurs blockbusters. Voici 4 exemples de pépites thérapeutiques.
1) Inhibiteur de TYK2 (antiinflammtoire) TAKEDA / NIMBUS
En décembre, Takeda a signé l’un des plus gros contrats pour un médicament non approuvé de l’histoire de l’industrie, payant à la biotechnologie Nimbus 4 milliards de dollars pour acquérir un médicament anti-inflammatoire expérimental en phase 2.
Le médicament de Nimbus est l’un des nombreux inhibiteurs de TYK2 en cours de test. Ces médicaments ciblent une enzyme impliquée dans l’inflammation et sont considérés comme des alternatives orales aux médicaments injectables comme Humira. Bristol Myers Squibb a commercialisé l’année dernière le premier inhibiteur de TYK2, Sotyktu, pour le psoriasis en plaques.
2) Datopotamab deruxtecan ASTRA ZENECA DAIICHI SANKYO
L’un des accords de licence de médicaments les plus réussis de l’histoire récente a eu lieu en 2019, lorsqu’AstraZeneca a accepté de payer à Daiichi Sankyo jusqu’à 6,9 milliards de dollars pour un morceau d’un médicament anticancéreux développé par la société japonaise. Depuis lors, le médicament, désormais vendu sous le nom d’Enhertu pour plusieurs types de tumeurs, est devenu un pilier des soins contre le cancer du sein. Les analystes s’attendent à ce qu’il génère plus de 6 milliards de dollars de revenus annuels d’ici 2026.
AstraZeneca et Daiichi axent leur recherche sur un médicament connu sous le nom de datopotamab deruxtecan. Comme Enhertu, il s’agit d’un conjugué anticorps-médicament, un médicament qui lie un produit chimique tueur de tumeurs à un anticorps ciblé. Et comme pour Enhertu, AstraZeneca a payé pour s’en procurer, acceptant de remettre jusqu’à 6 milliards de dollars à Daiichi si le médicament atteint une série d’étapes. La plus grande différence entre les deux est leur cible. Enhertu recherche la protéine cancéreuse HER2, tandis que le datopotamab deruxtecan se concentre sur une protéine appelée TROP2. Les partenaires le testent pour un éventail de tumeurs.
3) MOUNJARO / LILLY
Le nouveau médicament approuvé de Lilly, Mounjaro, est plus que le dernier médicament contre le diabète. Un traitement unique en son genre qui contrôle la glycémie de multiples façons, Mounjaro a également montré une capacité frappante dans les tests cliniques à réduire le poids – une caractéristique qui en a fait l’un des médicaments les plus surveillés de l’industrie.
Dans un essai de phase 3 appelé SURMOUNT-1, une dose hebdomadaire élevée de Mounjaro a conduit les participants obèses à l’étude à perdre environ un cinquième de leur poids corporel en 72 semaines. Lilly espère que ces résultats pourront aider à soutenir l’approbation de Mounjaro en tant que traitement de perte de poids, ouvrant la porte à de nouveaux revenus. Mais Mounjaro doit d’abord réussir une deuxième grande étude connue sous le nom de SURMOUNT-2.
4) DUPIXENT SANOFI / REGENERON
Sanofi et Regeneron ont déjà décroché de l’or avec leur médicament anti-inflammatoire Dupixent. Un anticorps qu’ils ont co-développé, Dupixent a été approuvé pour la première fois en 2017 et a depuis obtenu des autorisations pour cinq maladies différentes. En cours de route, il est devenu l’un des médicaments les plus vendus de l’industrie. Les ventes ont atteint plus de 6 milliards de dollars dans le monde en 2021.
Le médicament est en cours d’évaluation dans la maladie pulmonaire obstructive chronique, ou BPCO, qui est l’une des principales causes de décès dans le monde. C’est aussi une condition complexe que les médicaments biologiques n’ont pas traitée efficacement. Les meilleurs médicaments d’AstraZeneca et de GSK, par exemple, ont échoué à de grands tests dans la BPCO ou ont été rejetés par les régulateurs.
Les dirigeants de Regeneron pensent que Dupixent pourrait réussir car la société le teste sur un sous-ensemble de patients atteints de BPCO atteints d’inflammation de type 2, un type de réponse immunitaire avec lequel il a été démontré que le médicament interfère dans d’autres conditions.
Source : Biopharmadive