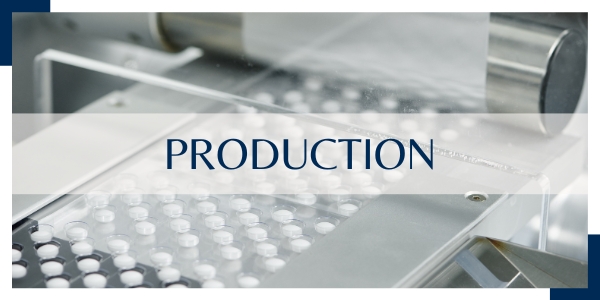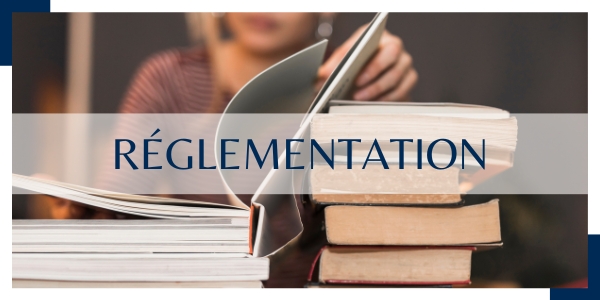
Délivrance des médicaments
L’EDQM publie un document stratégique intitulé « Orientations relatives aux principaux aspects de la publication de recommandations pour la classification des conditions de délivrance des substances actives (avec ou sans prescription)
Ce guide, publié le 29 septembre 2025, présente la nouvelle méthode d’évaluation adoptée par le Comité d’Experts sur la classification des médicaments en matière de leur délivrance (CD-P-PH/PHO).
Il vise à soutenir les autorités nationales compétentes (ANC), les titulaires d’autorisation de mise sur le marché (TAMM) et les autres parties prenantes dans l’évaluation du statut de prescription des médicaments. Il propose une méthode structurée pour déterminer si une substance active doit être soumise à prescription, en tenant compte de :
- Les caractéristiques de la substance et de la forme pharmaceutique
- Les indications thérapeutiques
- Le profil d’innocuité
- Le niveau d’expertise requis pour le diagnostic et le traitement
- Les risques de mésusage ou d’utilisation inappropriée
Lorsque les analyses scientifiques démontrent que les bénéfices d’un médicament surpassent clairement les risques, le Comité d’Experts CD-P-PH/PHO recommande de ne pas soumettre la substance à prescription ou de déroger à l’obligation de prescription. Ces évaluations sont disponibles sur la page « Base de données et publications » de l’EDQM.
Le comité CD-P-PH/PHO, présidé actuellement par Sandra Monteiro (Infarmed, Portugal), joue un rôle clé dans la classification des médicaments en Europe. Il œuvre à la bonne classification des médicaments sur le territoire européen, en aidant à déterminer s’ils doivent ou non être soumis à prescription. Il a pour mission de promouvoir un accès efficace et sans danger aux médicaments en fournissant des orientations aux autorités nationales, en favorisant l’harmonisation entre pays et en protégeant la santé publique.
Les nouvelles orientations sont disponibles gratuitement sur la plateforme FreePub de l’EDQM.
Source : EDQM