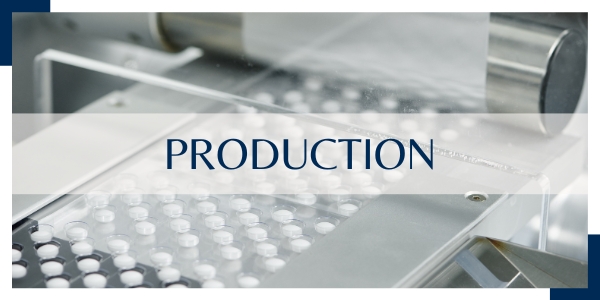
Investissements industriels chez NORGINE
Une nouvelle unité de fabrication va être installée chez NORGINE à Dreux. Avec à la clé la création d’une cinquantaine d’emplois.
La direction du groupe pharmaceutique Norgine Pharma a annoncé l’ouverture d’une nouvelle unité de fabrication et conditionnement.
Ce sera 18 millions d’investissement, avec une cinquantaine d’emplois créés d’ici à 2027 et le doublement de la capacité du site de production de Dreux.
Selon les journaux locaux, le chantier va durer entre 8 et 10 mois et va commencer d’ici à la fin de l’année 2024.
Olivier Marleix, député LR de Dreux, Christelle Minard, vice-présidente de l’Agglo du Pays de Dreux, Jean-Michel Poisson, premier adjoint au maire de Dreux et bien sûr Christophe Heriard, le sous-préfet de l’arrondissement de Dreux, ont profité de cette annonce officielle de Christopher Bath, le PDG du groupe et Cédric Aillerie, le directeur du site de Dreux pour redire » l’importance de l’industrie pharmaceutique pour la région et le département et leur volonté d’accompagner Norgine dans ses projets«
Cet investissement va permettre d’ouvrir de nouvelles unités de fabrication et de conditionnement de médicaments de gastro-entérologie de nouvelle génération.
Il s’agit en particulier d’un produit utilisé dans le dépistage du cancer colorectal et d’un autre destiné aux enfants suivant une chimiothérapie,
Cela permet à Norgine de renforcer son engagement pour mieux répondre aux besoins des patients et de favoriser le dépistage du cancer colorectal qui tue encore 17.000 personnes en France chaque année.
Source : Dreux Actualités



