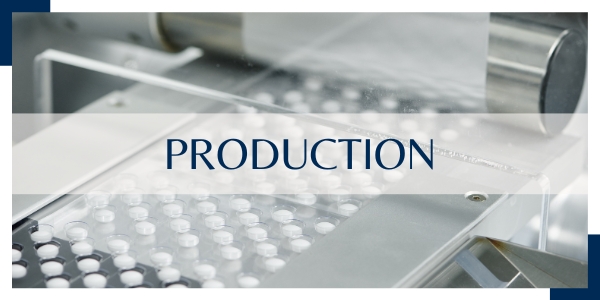Les sprays nasaux en OTC
Un essai montre que les sprays nasaux en vente libre pourraient contribuer à réduire les infections des voies respiratoires supérieures, ainsi que l’utilisation d’antibiotiques.
Un nouvel essai mené par des chercheurs de l’université de Southampton en partenariat avec l’université de Bristol a révélé que les sprays nasaux en vente libre pourraient contribuer à réduire les infections des voies respiratoires supérieures, ainsi que l’utilisation d’antibiotiques.
L’étude, publiée dans le Lancet Respiratory Medicine et financée par le National Institute for Health and Care Research, a révélé que les sprays nasaux pouvaient prévenir l’apparition de symptômes graves d’infections des voies respiratoires supérieures. Touchant une personne sur cinq en Angleterre, les infections des voies respiratoires supérieures sont des infections des parties du corps impliquées dans la respiration, notamment les sinus, la gorge, les voies respiratoires ou les poumons. Affectant les parties supérieures du système respiratoire, telles que les sinus et la gorge, les infections des voies respiratoires supérieures se manifestent par un écoulement nasal, des maux de gorge et de la toux.
Les chercheurs ont analysé les données de près de 14 000 adultes issus de 322 cabinets de médecins généralistes qui présentaient des problèmes de santé ou des facteurs de risque d’infection, notamment deux problèmes de santé existants, un système immunitaire affaibli par une maladie grave ou des médicaments, ou des infections respiratoires récurrentes dans le passé.
Les participants ont reçu soit un spray nasal à base de gel Vicks First Defence – un microgel qui piège les virus, soit un spray nasal salin – un mélange de sel et d’eau qui réduit les niveaux de virus, soit une ressource en ligne promouvant l’activité physique et la gestion du stress.
L’étude a révélé que les trois groupes ont connu une réduction de 25 % du nombre de jours de symptômes graves et d’utilisation d’antibiotiques, tandis que les deux sprays nasaux ont raccourci la durée de la maladie de 20 %, entraînant une réduction des jours d’arrêt de travail pouvant aller jusqu’à 30 %, tandis que le groupe pratiquant une activité physique et réduisant le stress a connu une réduction de 5 % des symptômes.
Le Dr Adam Geraghty, professeur agrégé de psychologie et de médecine comportementale à l’université de Southampton, a commenté l’étude : « Si elles sont largement utilisées, ces interventions pourraient jouer un rôle précieux dans la réduction de l’utilisation des antibiotiques et de la résistance aux antimicrobiens, ainsi que dans la réduction de l’impact des virus respiratoires sur les patients, les services de santé et l’économie en général. »
Source : Pharmatimes