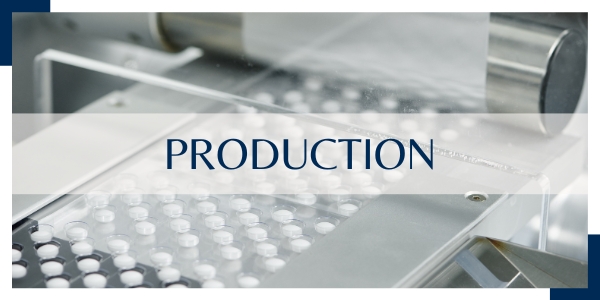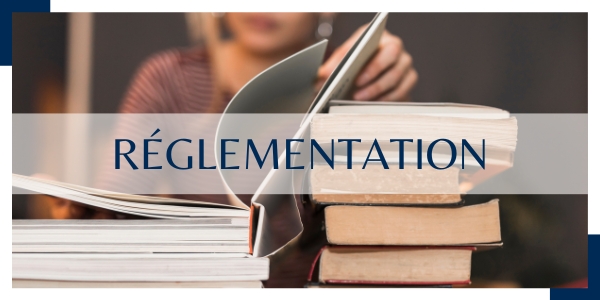L’ANSM a lancé une phase pilote qui vise à faciliter l’accès des patients et des professionnels de santé aux versions numériques des notices de certains médicaments à usage humain et l’EMA publie son rapport sur l’ePI.
L’ANSM a lancé une phase pilote qui vise à faciliter l’accès des patients et des professionnels de santé aux versions numériques des notices de certains médicaments à usage humain. Cette phase pilote repose sur des laboratoires volontaires qui ont répondu à l’appel à candidatures lancé par l’ANSM en juillet dernier.
Il s’agit de faciliter l’accès à tous, patients comme professionnels de santé :
- À une information dématérialisée : les utilisateurs pourront accéder à la notice numérique à tout moment, où qu’ils soient, en flashant le QR code avec leur smartphone ou tablette. Une réflexion spécifique sera par ailleurs menée sur l’accès à cette information pour les patients hospitalisés.
- À une information actualisée : les notices numériques disponibles dans la Base de données publique des médicaments (BDPM) sont actualisées régulièrement, ce qui garantit que les utilisateurs disposent toujours des informations les plus récentes.
- À des contenus additionnels : la BDPM offrira également des fonctionnalités supplémentaires telles que la mise à disposition de vidéos sur le bon usage sur la base d’un contenu défini et validé par l’ANSM, l’accès aux mesures additionnelles de réduction du risque (MARR) et aux dossiers thématiques publiés sur le site de l’ANSM. En particulier, les vidéos de bon usage sont une composante essentielle demandée par l’ANSM dans le cadre de la phase pilote en ville. Elles constituent un élément supplémentaire d’accompagnement des patients pour une utilisation en toute sécurité de ces médicaments.
En ville, 93 médicaments devraient faire partie de la phase pilote : du paracétamol (formes orales destinées à l’adulte), des statines (utilisées notamment dans le traitement du cholestérol ou des maladies cardiovasculaires), des vaccins ou encore des inhibiteurs de la pompe à protons (médicaments utilisés pour réduire la sécrétion acide gastrique). Concernant l’hôpital, 474 médicaments devraient faire partie de la phase pilote.
À partir du lancement du projet ce 17 décembre, les industriels y participant devront modifier les boites de leurs médicaments pour ajouter un QR code sur les boites en ville et supprimer la notice papier pour l’hôpital. Les QR code permettront d’accéder aux notices numériques en renvoyant vers la base de données publique des médicaments. Il a été convenu que la phase pilote démarrera de façon concrète à partir du 1er octobre 2025, date à laquelle suffisamment de boites modifiées seront effectivement à disposition des pharmacies et qui constituera le point de départ pour évaluer les résultats de cette phase pilote.
Tout au long de la phase pilote, un comité de suivi rassemblant l’ensemble des parties prenantes, représentants des patients, des professionnels de santé et des industriels, se réunira régulièrement. Il permettra d’échanger sur l’avancée de la phase pilote, d’identifier les éventuelles difficultés, et de mesurer les résultats en fonction des indicateurs définis collégialement.
Cette phase pilote s’inscrit plus largement dans la stratégie portée par la Commission européenne dans le cadre de la révision de la législation pharmaceutique. Cette stratégie soutient activement la mise à disposition d’outils numériques visant à améliorer l’accès des patients et des professionnels de santé à des informations enrichies et actualisées sur les médicaments. Elle rejoint également des expérimentations similaires réalisées à l’hôpital dans d’autres Etats membres de l’union européenne.
De son côté, l’EMA a publié un rapport détaillé présentant les résultats du projet pilote dans lequel l’EMA et un groupe d’autorités nationales compétentes de l’UE ont testé l’utilisation de l’ePI (electronic Product Information) dans le cadre d’un projet pilote d’un an, de juillet 2023 à août 2024. Le rapport inclut des recommandations pour l’intégration de l’ePI dans les procédures réglementaires. Le développement et l’amélioration des fonctionnalités de l’ePI sur le portail PLM sont en cours et se concentrent sur les caractéristiques essentielles pour la mise en service initiale. Il est prévu qu’une fois ces fonctionnalités en place, l’ePI sera introduit sur une base volontaire, dans un premier temps pour les produits autorisés en procédures centralisées. L’ePI sera ensuite déployé dans l’ensemble des autorités compétentes nationales selon une approche progressive, en tenant compte de l’état de préparation et des ressources des États membres.
Source : ANSM et EMA