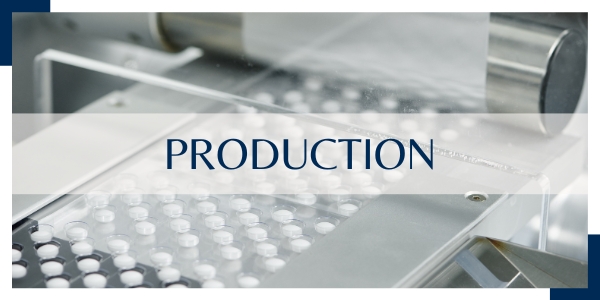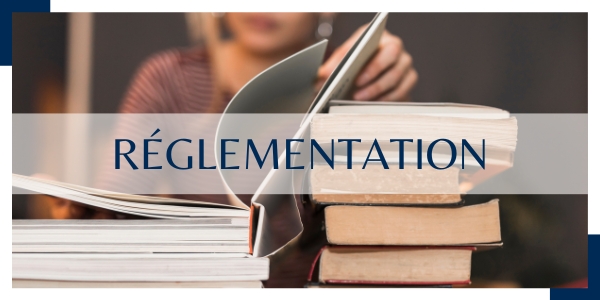Quelques acquisitions récentes dans la pharma.
Cette semaine quelques big pharma annoncent des acquisitions de produits et partenariats de licences : SANOFI, ROCHE, PFIZER, ABBVIE.
SANOFI (France)/ VIGIL (USA)
Sanofi annonce pour 470 millions de dollars, l’acquisition de Vigil Neuroscience, une société de biotechnologie spécialisée dans le traitement de maladies neurodégénératives. Sanofi inclut le VG-3927, qui fera l’objet d’une étude clinique de phase II pour le traitement de la maladie d’Alzheimer. Le VG-3927 est une petite molécule agoniste de la TREM2, ce qui devrait renforcer la fonction neuroprotectrice de la microglie.
ROCHE (Suisse) / ORIONIS (USA)
Orionis Biosciences a annoncé une deuxième collaboration pluriannuelle avec Genentech, membre du groupe Roche, pour découvrir des médicaments à base de colle monovalente à petites molécules pour des cibles nouvelles et difficiles en oncologie. Orionis recevra un paiement initial de 105 millions de dollars. Le total des montants de développement pourrait dépasser 2 milliards de dollars.
PFIZER (USA) / 3SBIO (Chine)
Pfizer achète au chinois 3SBio les droits mondiaux d’un anticancéreux en développement pour 1,25 milliard de dollars en front cash. Et jusqu’à 4,8 milliards en cas de succès clinique et commercial. SSGJ-707 est un anticorps bispécifique ciblant PD-1 et VEGF, fait actuellement l’objet de plusieurs essais cliniques en Chine pour le cancer du poumon non à petites cellules, le cancer colorectal métastatique et les tumeurs gynécologiques.
ABBVIE (USA) / ADARx (USA)
AbbVie et ADARx Pharmaceuticals ont annoncé un accord de collaboration et d’option de licence pour développer des thérapies à base de petits ARN interférents (siRNA) dans de nombreux domaines thérapeutiques, notamment les neurosciences, l’immunologie et l’oncologie. Selon les termes de l’accord, ADARx recevra un paiement initial de 335 millions de dollars.
Sources : Communiqués des entreprises